|
| | Le sionisme et Israël : quelle légalité internationale ? |  |
| | | Auteur | Message |
|---|
Stans
Fondateur
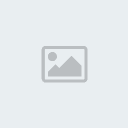

Nombre de messages : 16069
Age : 72
Localisation : Bruxelles - Département de la Dyle
Langue : français
Emploi/loisirs : histoire, politique
Date d'inscription : 10/03/2006
 |  Sujet: Le sionisme et Israël : quelle légalité internationale ? Sujet: Le sionisme et Israël : quelle légalité internationale ?  Lun 12 Juin 2006, 3:30 pm Lun 12 Juin 2006, 3:30 pm | |
| Texte de SBJ - Citation :
- Voici un texte intéressant de Frédéric Encel, spécialiste de la géopolitique du Proche-Orient sur la légalité du sionisme et de l'Etat d'Israël. (extrait du site : http://www.atlantis.org/publications_encel022.html )
L'une des principales critiques existentielles formulées à l’encontre d’Israël, ou de l’idéal sioniste qui l’a engendré, porte sur un déficit de légitimité juridique, autrement dit de légalité aux yeux du droit international tel qu’il est défini dans son acception contemporaine. Quelques éléments objectifs fondent pourtant pour les Israéliens – au-delà des aspects moraux, politiques ou historiques – cette légalité.
En premier lieu, nul texte de droit international ne fonde l’aspiration d’un peuple en particulier à se percevoir comme une nation ayant droit à la souveraineté sur un territoire représenté comme le sien. Les Etats français, chinois, cubain, libyen, seraient aujourd’hui bien en peine – ainsi que l’Autorité palestinienne du reste – de démontrer la validité de la prétention des peuples qu’ils encadrent respectivement à se percevoir comme des peuples dotés d’un droit historique sui generis. Qui a « accordé » aux Français le droit de se représenter comme un peuple et, partant, de bâtir un Etat fondé sur ce principe primordial ? Qui a « accordé » aux Palestiniens le droit de s’affirmer « peuple » ? Ainsi posée, la question n’a naturellement aucun sens. Elle n’en a guère davantage appliquée à Israël. Une nation est avant tout une représentation ou, dans l’acception d’Ernest Renan, « une âme, un principe spirituel ».
Qui a « accordé » aux Français le droit de se représenter comme un peuple et, partant, de bâtir un Etat fondé sur ce principe primordial ? Qui a « accordé » aux Palestiniens le droit de s’affirmer « peuple » ? Ainsi posée, la question n’a naturellement aucun sens. Elle n’en a guère davantage appliquée à Israël
En second lieu, il convient de noter que la Déclaration Balfour du 2 novembre 1917, selon laquelle « le gouvernement de sa Majesté [britannique] envisage favorablement l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif », offre une reconnaissance officielle valant légitimité. Les détracteurs du sionisme objectent que ce texte n’émanait pas alors d’un organisme international reconnu comme représentatif des nations, et qu’il n’évoquait qu’un « foyer national » (homeland) et non un Etat, Etat que – par ailleurs – la puissance mandataire britannique n’accordera jamais au mouvement sioniste. Exacts, ces deux faits n’en constituent pourtant pas aux yeux des Israéliens des arguments fondés, pour les raisons suivantes : d’abord ni la Société des Nations (SDN) ni l’ONU n’existaient alors ; elles seront respectivement fondées en 1919 et 1945. En 1917, sauf pour des conventions ratifiées par certains Etats dans quelques domaines (droit de la guerre notamment), et une Cour pénale internationale au poids tout à fait marginal, on ne peut réellement parler de communauté internationale régie par un droit spécifique. Or les puissances signataires du traité de San Remo d’avril 1920 intègrent à leurs conclusions cette déclaration Balfour, conclusions entérinées par l’article 95 du traité de Sèvres signé quatre mois plus tard.
En troisième lieu, et là réside précisément le socle de légitimité fondamentale du sionisme, l’Article 2 du Chapitre Premier de la Charte des Nations Unies dispose que parmi les buts et les principes de celle-ci, il s’agit de « développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes ». Si les (ou un certain nombre de) Juifs constituent un peuple, la cause est entendue. Quant à la localisation géographique précise qui doit correspondre à ce peuple, qui pourrait s’arroger le droit d’en décider à la place du peuple intéressé ? A cet égard, c’est l’ONU qui décide très officiellement de cette localisation géographique de l’Etat du peuple juif. Le plan de partage onusien du 29 novembre 1947, adopté de manière régulière (vote à la majorité qualifiée des deux tiers) et conforme à la lettre et à l’esprit de la Charte des Nations-Unies, entre un Etat juif, un Etat arabe, et un corpus separatum pour la zone Jérusalem-Bethléem, fonde en droit international la légitimité de l’Etat juif de Palestine, lequel sera baptisé en mai 1948 « Etat d’Israël » par l’Exécutif de l’Organisation sioniste mondiale (OSM). Une légitimité d’autant moins contestable que l’OSM accepte alors sans réserve la résolution onusienne n° 181 qui entérine le plan de partage, a contrario des Etats de la Ligue arabe et du mufti de Jérusalem Hadj Amine el-Husseini, lequel ne bénéficie d’aucune représentativité politique reconnue. Surtout, l’ONU admet officiellement et définitivement en son sein l’Etat d’Israël, le 11 mai 1949.
Enfin, si l’Assemblée générale des Nations-Unies adopta bien la résolution 3379, non contraignante et votée le 10 novembre 1975 (majorité arabo-africano-soviétique), assimilant le sionisme à une forme de racisme, cette résolution fut purement et simplement annulée par une autre résolution de même nature adoptée le 16 décembre 1991, immédiatement après la chute de l’empire soviétique. A ce jour, nul texte s’inscrivant dans le droit international ne mentionne donc le sionisme de manière dévalorisante ou négative, de quelque manière que ce soit, et seuls quelques rares Etats ne reconnaissent toujours pas Israël.
Reconnaître la qualité essentielle et valorisante de peuple à toute population et refuser ce droit fondamental aux Juifs, ne serait-ce pas faire œuvre de ségrégation ?
Au fond, la question fondamentale est la suivante : si Français, Camerounais, Laotiens, Luxembourgeois et autres Palestiniens sont admis comme des peuples – dotés donc collectivement de droits moraux, juridiques, politiques, nationaux précis – que les Juifs ne le seraient-ils pas, avec des droits nationaux identiques sur un espace incontestablement ancestral ? Reconnaître la qualité essentielle et valorisante de peuple à toute population – même numériquement fort réduite et/ou dépourvue de conscience nationale – et refuser ce droit fondamental aux Juifs – du moins à ceux qui souhaitent se représenter comme membres d’un peuple – ne serait-ce pas faire œuvre de ségrégation ?
Ici, s’attarder sur les condition et détails du plan de partage de la Palestine en deux Etats n’est peut-être pas inutile. En juillet 1922, la puissance mandataire britannique procède à un découpage arbitraire et unilatéral de la Palestine : la Transjordanie (outre-Jourdain), 74% de la Palestine mandataire, est offerte à l’Emir hachémite Abdallah, fils du shérif de La Mecque allié contre les Turcs en 1916-18. Sur le territoire restant, l’antagonisme sans cesse plus profond et meurtrier entre Arabes et Juifs en Palestine, dans les années 1920-30, pousse la puissance mandataire à suggérer un premier plan de partage de la zone en 1937 ; suivant les conclusions de la Commission royale présidée par Lord Robert Peel sur la Palestine, Londres envisage la création d’un micro-Etat juif d’environ 5 000 km², le reste (24 000 km²) revenant à la Transjordanie. Accepté par l’Exécutif sioniste, le plan est rejeté par les notables et les chancelleries arabes ; l’Irak craint par exemple un accroissement de puissance de son voisin transjordanien.
Le second plan, britannique également, émane de la Commission John Woodhead qui suggère trois découpages territoriaux considérés comme impraticables sur le terrain par le gouvernement et l’état-major. Enfin l’aggravation des tensions judéo-arabes suivant la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 1945-47 – ainsi que les pressions croissantes des opinions publiques britannique (du fait du coût de l’occupation) et américaine (à cause de l’ampleur de la Shoah) – contraignent Londres à confier le dossier à une commission onusienne, l’United Nations Special Commitee on Palestine (UNSCOP), laquelle remet son rapport le 31 août 1947. Le 29 novembre, celle-ci l’adopte donc par la majorité requise des deux tiers ; majorité atteinte après d’intenses tractations auprès de modestes Etats latino-américains, Etats-Unis et Union soviétique d’une part, Etats arabo-musulmans d’autre part. En définitive, 33 Etats votent en faveur du plan de partage, contre 13 contre et 10 abstentions.
Le plan de partition de 1947 est accepté par l'Organisation sioniste mondiale, tandis que le haut Comité arabe palestinien ainsi que toutes les capitales arabes le rejettent
Le plan de partition prévoit trois zones distinctes : un Etat juif comprenant la plaine côtière de Ashdod à Saint Jean d’Accre, la Galilée orientale, et l’essentiel du désert du Néguev ; un Etat arabe incluant la majeure partie de la Galilée, la Cisjordanie augmentée, la bande de Gaza et une partie nord-ouest du Néguev ; enfin un corpus separatum internationalisé sur Jérusalem et Bethléem. Une fois encore, l’Organiation sioniste mondiale (OSM) accepte officiellement le plan, tandis que le haut Comité arabe [palestinien], le Mufti de Jérusalem Hadj Amine el-Husseini, ainsi que toutes les capitales arabes le rejettent. Londres indique que ses troupes quitteront définitivement et unilatéralement la Palestine le 15 mai 1948.
L’Organisation sioniste mondiale (OSM), par la voix de son exécutif, accepte immédiatement la résolution 181 entérinant le plan de partage, cependant que tous les Etats de la Ligue arabe la rejettent. De fait, la résolution ne sera jamais appliquée : entre le 14 et le 15 mai, Ben Gourion proclame l’Indépendance, les armées arabes envahissent l’Etat juif naissant, et l’armée britannique se retire. La guerre israélo-arabe qui s’ensuit modifie considérablement le tracé du plan de partage onusien, et efface l’Etat arabe de Palestine au profit de la Transjordanie et, dans une moindre mesure, d’Israël et de l’Egypte. En décembre 1948, une commission de conciliation est mise sur pied par l’ONU – qui comprend notamment les Etats-Unis, la France et la Turquie – avec pour objectif de faire appliquer la résolution 181 aux belligérants israélien et arabes. Ses travaux se concluent finalement par un échec.
Cette guerre d’Indépendance d’Israël, ou première guerre israélo-arabe (mai 1948-mars 1949), modifiera considérablement les limites et la nature de certaines des zones établies par l’ONU ; Jérusalem est ainsi coupée en deux secteurs nationaux, israélien et transjordanien, tandis que l’Egypte, Israël et surtout la Transjordanie prennent définitivement possession des territoires dévolus originellement à l’Etat arabe de Palestine.
En conclusion, si l'on peut très légitimement critiquer tel aspect de la démarche sioniste puis des différentes politiques gouvernementales israéliennes depuis 1948, on ne peut sans tomber dans l'outrance dénoncer son illégalité en droit international.
Frédéric Encel, docteur en géopolitique, est Fellow à l'Atlantis Institute | |
|   | | | | Le sionisme et Israël : quelle légalité internationale ? |  |
|
Sujets similaires |  |
|
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
| |
| |
| |
